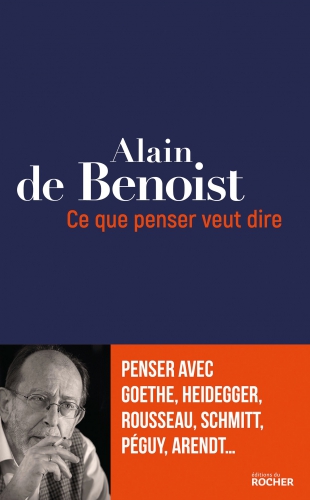Pourquoi je me sens gaullien
«Et le Général revint. J’avoue que moi-même, à cause des politiciens et des partis, je n’avais plus qu’une image brouillée et plutôt salie de ma France. Elle louchait. Elle se jetait dans les bras d’amants anglais ou américains. Elle buvait du vin rouge acheté aux négociants communistes. Elle avait un côté Gervaise, ma pauvre mère, qui ne me rendait pas fier. Et voilà qu’elle venait de se remarier avec un militaire un peu cinglé ! Qu’allait-il arriver ? Il arriva la France ».
Dans Pourquoi la France (Table ronde, 1975), Jean Cau évoque le retour « aux affaires » du général de Gaulle. On connaît ces mots sur lesquels s’ouvrent les Mémoires du Général : «Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l’inspire aussi bien que la raison ». De Gaulle se faisait en effet une certaine idée de la France. Il s’en faisait aussi une de lui-même, et jamais durant sa vie la conviction ne l’abandonna d’être voué à une « destinée éminente et exceptionnelle ». Les deux idées, a-t-on dit, tendaient à se confondre. Et pourquoi pas ? Les idées sont d’autant plus vraies qu’elles sont incarnées. «La gloire se donne seulement à ceux qui l’ont rêvée », lisait-on déjà dans Vers l’armée de métier.
Dans un livre qu’il vient de faire paraître, Alain Griotteray énonce trois grands principes gaulliens : « 1) Réponds à la menace par la menace, à la volonté par la volonté. 2) Ne laisse plus à d’autres, même à des alliés, le soin de designer ton adversaire. 3) Aie toujours des ennemis, mais jamais d’ennemi absolu, aie toujours des alliés, mais jamais d’amis absolus » (Lettre aux giscardo-gaullistes sur une certaine idée de la France, Mengès, 1980). Ces trois principes pourraient se résumer en un seul : agir selon l’intérêt national, et rien d’autre. L’intérêt national, c’est-à-dire l’intérêt de la France et des Français. Non l’intérêt supposé d’un homme universel : de Gaulle aurait souri de cette « religion des droits de l’homme» qui nie la spécificité du politique, grignote les souverainetés nationales, ramène l’action historique aux bonnes oeuvres, et soumet les rapports internationaux aux critères de la démocratie biblique à l’anglo-saxonne. De Gaulle n’avait que méfiance pour les instances internationales qui prétendent se substituer aux États : l’ONU était pour lui au mieux un « forum utile », au pis un « machin ». Le rôle d’un chef d’État n’est pas de s’interroger sur ce qui, dans l’abstrait, est le plus moral ou le plus « vrai », mais de discerner ce qui est le plus conforme aux intérêts nationaux.
C’est avec une puissance politique, fondée et garantie par la souveraineté nationale, que l’on peut réellement défendre les libertés. « L’indépendance est la condition de l’intégrité, écrit Stanley Hoffmann. L’intégrité est la substance de l’amour-propre. Et l’amour-propre, ou la dignité, valeur centrale, ne se trouve que dans la grandeur » (De Gaulle, artiste de la politique, Seuil, 1973). Qu’est-ce que la grandeur ? Alexandre Sanguinetti a répondu : «C’est être soi-même, exister, représenter son génie propre » (Une nouvelle résistance, Plon, 1976).
De Gaulle savait que la politique n’était pas faite d’états d’âme, mais de volonté. Dans Vers l’armée de métier, il affirme : « Il faut que les maîtres aient une âme de maîtres ». Et encore : « L’épée est l’axe du monde et la grandeur ne se divise pas ». Plus tard, il dira : « Pour un ministre, le salut de l’État doit l’emporter sur tous les sentiments » (Mémoires, vol. 1). Il voulait que la France fût gouvernée, et non pas gérée. Il voulait une direction, non une régulation. Il n’avait pas de programme, mais un projet. La puissance, pensait-il encore, est aussi une condition du bonheur. Avec cela, une vision d’écrivain, et même d’artiste. La conviction que le contenu d’une politique n’est pas dissociable de son style. Pascal Ory fait de lui un «monarchiste de regret » (De Gaulle, Masson, 1978). Mais ce monarchiste égaré en démocratie sut aussi ne pas se nourrir d’illusions sur les prétendants ! « Charles de Gaulle est un Franc, écrit Sanguinetti, non pas salien mais ripuaire, élu par ses leudes, qu’il appelle compagnons, un officier des marches de l’Est [...] un homme du droit coutumier que ne convainc pas absolument le droit écrit – on le verra bien dans sa façon de concevoir et d’appliquer les institutions –, un homme du Nord qui se méfie des populations méridionales, qui le lui rendront bien, à l’exception de celles qui n’auront pas connu le catharisme ».
Dans le dossier que la revue Histoire-Magazine consacre ce mois-ci à de Gaulle, Paul-Marie de La Gorce rappelle que le Général, revenant au pouvoir en 1958, s’était fixé trois objectifs : réformer profondément les institutions de la IVe République, entachées de partitocratisme et d’impuissance ; créer un système où la France et ses anciennes colonies se trouveraient associées par des rapports de coopération privilégiés ; enfin, renverser le système des relations internationales « dans lequel la France était enfermée par le jeu de l’intégration militaire dans l’organisation atlantique et la subordination politique qui en résultait ». Avec la Constitution de 1958, la France se trouve à nouveau gouvernée. L’élection du président de la République au suffrage universel devait s’y ajouter par la suite, afin que « le chef de l’État ne provienne d’aucun parti, qu’il soit désigné par le peuple ».
Le peuple : autre mot-clé. De Gaulle a constamment répété qu’il ne pouvait mener sa mission sans le soutien du peuple. « La démocratie, déclare-t-il à Londres, se confond exactement, pour moi, avec la souveraineté nationale. La démocratie, c’est le gouvernement du peuple exerçant sa souveraineté sans entrave » (27 mai 1942). Renouant avec une antique tradition, il cherchera, à partir de 1958, à établir entre le pouvoir et le peuple un lien direct, passant au-dessus des notables, des assemblées et des partis. D’où le recours au référendum. En octobre 1962, quand le Général propose l’élection du président au suffrage universel, l’Assemblée nationale renverse le gouvernement. Mais le peuple, consulté, approuve. La nouvelle procédure sera ausstôt instaurée.
On a décrit de Gaulle comme le « plus grand commun diviseur » des Français. Pourtant, nul n’a comme lui fait l’unanimité. « La Ve République naît autour d’un chef charismatique », observait Raymond Aron en février 1959. D’autres ont parlé d’« envoûtement des masses ». Mais l’étonnant est que cette emprise ait survécu aux départs de 1946 et de 1969. Selon un sondage, également publié par Histoire-Magazine, 81 % des Français estiment aujourd’hui que l’action du général de Gaulle fut positive. Ce chiffre ne fut jamais atteint du vivant du Général. Au vrai, si de Gaulle fut populaire, c’est d’abord parce qu’il ne chercha jamais à l’être. La France, pour lui, ne résultait pas seulement de l’addition des Français. Les Français peuvent être des héros ou des veaux, de l’or ou de la tourbe, cela ne change rien à la réalité de la France. De Gaulle fut accusé de mépriser les hommes. Pourquoi donc aurait-il dû les aimer ? Ce ne sont pas les hommes qu’il faut aimer, c’est ce qui les élève et les aide à grandir.
Les passions nées de la guerre d’Algérie s’apaiseront un jour. Les plaies douloureuses qu’elles ont ouvertes finiront par cicatriser. Aujourd’hui déjà, on voit mieux que l’émancipation des anciennes possessions françaises, ouvrant la voie à une politique concernant l’ensemble du Tiers-monde, était impliquée dans l’affirmation du principe d’indépendance et de souveraineté nationale. Ayant donné l’indépendance à ses anciennes colonies, la France pouvait se faire le champion de toutes les indépendances, à commencer par la sienne. Elle devenait ainsi, et l’Europe avec elle, la partenaire naturelle de tous ceux qui, dans un monde bipolaire, récusent l’hégémonie des superpuissances et entendent restituer au jeu politique international sa nécessaire pluralité.
De fait, le refus de la politique des blocs fut l’aspect le plus important de la politique gaullienne. De Gaulle condamna Yalta dès le premier jour. Il fut, après la guerre, le seul chef d’État européen à refuser le duopole russo-américain et les menaces – de nature différente – que chaque hégémonie, tirant prétexte de l’existence de l’autre, faisait peser sur nous.
De Gaulle n’a bien entendu jamais été hostile à l’Europe. Mais il ne voulait pas d’une Europe dépossédée d’elle-même. Il ne voulait pas de ce que Valéry a appelé le « gouvernement de l’Europe par une commission américaine ». De là son hostilité à la CED, son refus de l’entrée de la Grande-Bretagne – « commis voyageur » de l’Amérique – dans le Marché commun, sa guérilla monétaire contre le système de Bretton Woods et la prééminence du dollar. De Gaulle voulait une France française dans une Europe européenne – et une Europe entière, une Europe réunifiée, associant les patries des Gaulois, des Latins, des Germains et des Slaves, non une «Europe des Neuf », Europe-croupion réduite à n’être que l’«appendice occidental du monde atlantique », et qui abandonnerait pour toujours les peuples de l’Est à leur sort. Pour ce faire, il s’agissait qu’il y eût une politique de la France et qu’elle se fît à Paris. Il s’agissait ensuite que les deux moitiés de l’Europe fussent réunies et rejettent leur tutelle : «Oui, c’est l’Europe, depuis l’Atlantique jusqu’à l’Oural, c’est l’Europe, c’est toute l’Europe, qui décidera du destin du monde ! » (Strasbourg, novembre 1959).
Accomplissant ce que Carl Schmitt appelle le geste politique par excellence – la « désignation de l’ennemi » –, de Gaulle élabore ainsi une « stratégie tous azimuts ». Pour assurer son indépendance, la France doit pouvoir se défendre elle-même et se doter d’une force nucléaire de dissuasion. Il n’est plus possible, comme le dira Griotteray, que « trois cents millions d’Européens s’en remettent aux deux cents millions d’Américains pour se protéger de deux cents millions de Russes, eux-mêmes confrontés à neuf cents millions de Chinois ». Grâce à la force de frappe, il sera possible de rejeter les sujétions extérieures et de se passer du « parapluie troué »américain.
Partout dans le monde, de Gaulle donna une impulsion. Celle-ci ne passa pas – ne pouvait pas passer – immédiatement dans les faits. Mais il fallait prendre date. Quand de Gaulle déclare à Varsovie, en 1967, que « la Pologne a repris vis-à-vis du dehors la totale disposition d’elle-même », il n’exprime qu’un voeu. Mais qui dira comment ces paroles ont germé dans l’esprit des travailleurs de Dantzig (Gdansk) ?
Et le cri du 24 juillet 1967 : «Vive le Québec libre ! », qui dira de quelle manière il continue de résonner aujourd’hui ? La France entendait être souveraine. Au Québec et au Mexique, en Pologne et en Roumanie, de Gaulle dit aux pays satellites de suivre son exemple, de se libérer des influences étrangères et de redevenir eux-mêmes. Les idéologies passent, les peuples et les nations demeurent. Les dés lancés continuent de rouler.

C’est d’ailleurs cela le plus remarquable avec les initiatives gaulliennes : le fait qu’après avoir été critiquées de tous côtés, elles soient désormais admises par tout le monde. Lorsque la France entreprit d’assurer par elle-même sa défense nucléaire, Edgar Faure déclara : «Du point de vue militaire, la bombe ne présente aucun intérêt ». Qui souscrirait encore à cette opinion ? L’élection du président de la République au suffrage universel provoqua une levée de boucliers. Les partis, depuis, s’en sont tous accommodés. En 1964, la reconnaissance de la Chine populaire souleva la colère du département d’État, qui la jugea « inamicale ». Quelques années plus tard, Nixon était reçu en grande pompe à Pékin, et aujourd’hui, la politique chinoise de Washington bat son plein. Quant au départ du SHAPE, il provoqua des commentaires voisins de l’hystérie. Mais qui peut encore penser que les États-Unis prendraient le risque de se suicider pour défendre un continent européen dont les intérêts sont appelés à coïncider de moins en moins avec les leurs ?
Avec l’« homme du passé » que fut de Gaulle, la France est entrée de plain-pied dans l’avenir. En l’espace de onze ans, de 1958 à 1969, elle est devenue la cinquième puissance industrielle du monde, la troisième puissance commerciale, la troisième puissance aéronautique et spatiale, la troisième puissance nucléaire. C’était l’époque des «Trente glorieuses ». Contrairement à la légende, de Gaulle n’a jamais dit : «L’intendance suivra », mais il croyait au « politique d’abord » : il savait que les experts ne sont pas là pour décider, mais pour trouver les meilleurs moyens d’exécuter les orientations qu’on leur donne. En 1962, au cours d’une conférence de presse, il déclare : «Nous avons choisi d’être une économie de compétition ». Et l’intendance suivit.
On a parfois voulu se recommander d’une « doctrine » gaulliste. Or, de Gaulle était le contraire d’un idéologue. Dès 1925, citant Bugeaud, il constate : «A la guerre, il y a des principes, mais il y en a peu ». Comme tous les grands hommes, il avait le sens des situations. Pragmatique, et même « machiavélien », il ne fut jamais regardant sur le choix des tactiques ni sur celui des moyens. Par contre, il ne céda jamais sur les objectifs qu’il s’était fixés. «À propos de l’histoire, déclare-t-il en 1966 à André Passeron, je vais vous dire quelque chose : sachez que toutes les décisions que je prends, toutes les déclarations que je fais sont pour chaque domaine inspirées et guidées par une seule idée ; tout s’ordonne autour de cette idée claire et simple ». Le gaullisme, il ne faut pas l’oublier, n’est pas né d’une philosophie, mais d’un acte historique.
Maurice Clavel s’est demandé s’il ne fallait pas chercher la source du prestige du Général dans un mythe quasiment jungien. Il en tirait la conclusion que l’opposition, en réduisant de Gaulle à ce mythe, perdait parfaitement son temps. « La légende gaullienne, écrit Pascal Ory, réalise le rêve de l’individu collectif moderne : la totale préméditation d’une vie dans la totale identification à un destin général ». Que cette légende contienne sa part de vérités et d’erreurs n’a plus guère d’importance. Seul compte le mythe, car ce sont les mythes qui inspirent la volonté des hommes et les poussent à se donner un destin.
Révolutionnaire autant que conservateur, de Gaulle eut contre lui la droite, la gauche, les partis, l’Église, la bourgeoisie, les comités et les factions. Pour lui, il eut la France. Au vrai, rarement homme politique souleva autant de critiques passionnées, excessives, démesurées. Que n’a-t-on pas dit sur le « grand Charles » ? Les journaux satiriques se déchaînèrent contre lui. Il fut traité de « fasciste » et de « factieux » tout autant que de « communiste ». Voici quelques années, l’hebdomadaire anglais The Economist le taxa même d’avoir une conception « wagnérienne » de la politique – c’était apparemment pour ce journal le comble de l’horreur. De Gaulle, lui, restait indifférent. Indifférent à tout ce qui « grouille, grenouille et scribouille ». À Malraux, qui devait le rapporter plus tard (dans Les chênes qu’on abat, Gallimard, 1971), il déclare : «Voyez-vous, il y a quelque chose qui ne peut pas durer : l’irresponsabilité de l’intelligence. Ou bien elle cessera, ou bien la civilisation occidentale cessera ».
Du vivant du Général, je ne fus pas gaulliste. Aujourd’hui, je me sens très fortement gaullien. Est-ce du fait de mon évolution propre ou de celle des événements ? Je ne sais. Mais c’est un fait que les hommes s’apprécient aussi par rapport à ce qui vient après eux. Quand il n’y a plus que des nains pour s’agiter, les défauts des géants sont vite oubliés. Aujourd’hui, plutôt que la grandeur, on vante la petitesse, la mesquinerie, la sécurité, le réalisme comptable et le manque d’ambition. Les grands hommes ont cédé la place aux hommes « compétents ». Les gestionnaires ont remplacé les visionnaires. Chef d’État véritable à une époque où l’on n’aime pas beaucoup les chefs, et encore moins l’État, de Gaulle disait vers 1921 : «Préparer la guerre, c’est préparer des chefs ». Où s’en prépare-t-il aujourd’hui ? À l’automne de 1979, un sondage a révélé que 57 % des Français ne seraient à aucun prix prêts à risquer la mort pour défendre leur patrie au cas où une puissance étrangère occuperait le sol national. (On peut en conclure que les mêmes s’interdisent de condamner la Collaboration des années 1940). Il est dommage que la France paraisse peuplée de vieillards – dont beaucoup n’ont pas plus de dix-huit ans.
Dans sa Lettre aux giscardo-gaullistes, Alain Griotteray rompt des lances pour démontrer que Valéry Giscard d’Estaing poursuit aussi fidèlement que possible une politique gaullienne. J’admets volontiers avec lui que le gaullisme n’est plus aujourd’hui dans le gaullisme. Mais d’autres ont été plus sévères. Quand Giscard parle de « décrispation », ils rétorquent, avec Sanguinetti : « Le peuple français est tendu. L’histoire est tragique. On ne gouverne la France qu’en utilisant ses tensions ». Olivier Germain-Thomas, lui, dénonce Les rats-capitaines (Hallier, 1978). Et Pierre Lefranc, à propos de l’après-gaullisme, écrit : «On peut annoncer, sans risque d’indiscrétion, qu’il s’agit d’une fresque illustrant la petitesse des hommes » (...Avec qui vous savez, Plon, 1979).
Les temps auraient-ils changé ? Les grands hommes font les grandes époques, mais les grandes époques font aussi les grands hommes. Quand on aspire à ce qu’il ne se passe plus grand-chose, il est facile de croire que l’histoire peut finir. Mais l’histoire ne finit pas. Elle s’arrête là où Atlas baisse les bras. Elle reprend là où d’autres forces se préparent. De Gaulle fut l’« homme des tempêtes ». Il y a encore des tempêtes à venir.
Après l’échec du référendum du 27 avril 1969, le général de Gaulle s’envole vers l’Irlande. Je pense à une photo prise durant son voyage et qui, aujourd’hui, se trouve dans mon bureau. C’est presque une photo d’exil. Le Général y parcourt une grève déserte, au côté de sa femme, la canne au poing, vêtu d’un grand manteau noir. Il semble marcher à grandes enjambées, pensif et lointain. Le vent tourbillonne autour de lui. C’est là, en Irlande, qu’il dira : « J’ai confiance que les Français se souviennent de mon temps comme d’une époque digne, où on pensait d’abord à l’intérêt général et où on voyait les choses de haut ». Quelle gifle pour ceux qui ne voient les choses que d’en bas !
Alain de Benoist
(8 novembre 1980)